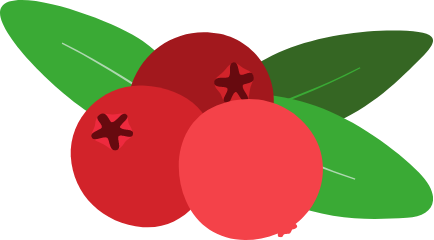François Brouillard: L'effeuilleur de forêt

Dans les yeux de François Brouillard, une butte de mauvaises herbes se transforme vite en un riche garde-manger. « Ça n’existe pas, les mauvaises herbes. Ce sont juste des plantes qui ne poussent pas à la bonne place », lance ce cueilleur expérimenté en se dirigeant vers un tapis de choux gras, une plante à feuilles vertes qui ressemble à s’y méprendre à… de la mauvaise herbe.
Une des « bonnes places » où les végétaux mal-aimés sont les bienvenus, c’est le tas de terre et de plantes brisées d’une vingtaine de mètres carrés de la Pépinière Villeneuve, à L’Assomption. L’amarante, le pourpier, la roquette sauvage et le pissenlit qui y prolifèrent seront dûment récoltés, grâce à une entente entre François et le propriétaire.
Du printemps à l’automne et du matin au soir, depuis plus de 30 ans, le fondateur de l’entreprise Les Jardins Sauvages parcourt le Québec d’est en ouest et du nord au sud, à la recherche de plantes, de champignons et de fruits indigènes. Il les vend, dans sa boutique du Marché Jean-Talon, à une poignée de restaurateurs, ou alors il les sert à la table gastronomique que tient sa conjointe à Saint-Roch-de-l’Achigan.
Ce « cueilleur des bois » partage ainsi avec les gens qui s’y intéressent des délices qui poussent sur le territoire du Québec depuis des siècles.
« Les Amérindiens ont toujours mangé du chou gras et des têtes de violon. Ces plantes font partie de notre terroir, elles sont délicieuses et nutritives, mais ce savoir s’est perdu. Les Français les ont remplacées par des épinards et des asperges. Notre climat nordique nous offre aussi toute une gamme d’aromates, comme l’achillée, les fleurs d’asclépiade et le persil de mer. Et pourtant, on cuisine avec le romarin, le thym et le basilic, qui ne sont pas typiques du Québec », déplore ce passionné, accroupi dans les feuilles, avant de couper au ciseau la tête d’un plant de chou gras.
Près de la pépinière, en pleine forêt, François pointe des strophaires rouge vin, de gros champignons, des mûres, de la surette, de la carotte sauvage et la salsepareille. On sent qu’on a pénétré dans son monde – et dans celui des Schtroumpfs. « Ma force, c’est la forêt. Perdue dans le bois avec moi, tu ne crèverais pas de faim ! » dit en rigolant cet homme qui pratique la cueillette depuis l’âge de cinq ans, initialement sous la sage supervision de ses parents et de ses grands-parents.
Le redoutable chasseur de champignons n’est pas peu fier d’avoir récemment découvert des emplacements d’amanites des Césars, de rares et impressionnants champignons à chapeau rouge en forme d’oeuf et au goût fromagé. Tout ça grâce à une savante étude du climat et à une recherche assidue. « Ça faisait quatre ans que je n’en avais pas vu ! »
Une ressource à protéger
Malgré sa passion pour son métier, François craint que l’avenir des plantes sauvages ne soit pas florissant. Il n’y a en effet que très peu de relève de qualité prête à trimer dur pour cueillir de gros volumes de ces végétaux.
« De bons cueilleurs, il n’y en a pas beaucoup. Les jeunes ne veulent pas faire ce travail, c’est trop pénible. Il faut passer toute la journée à quatre pattes pour amasser deux gallons de fraises des champs », constate le gaillard dont les mollets portent de nombreuses marques laissées par des buissons épineux de mûres sauvages.
En même temps, François en a contre ceux qui s’improvisent cueilleurs et mettent le terroir en péril. Il explique, par exemple, avec quelle minutie il faut récolter la salicorne, une plante marine qui pousse sur les berges du Saint-Laurent.
« À la première cueillette de la saison, on pourrait en ramasser 200 livres, mais on en prend juste 30, en coupant les têtes. On donne ensuite une semaine de break à la plante, et toutes les tiges latérales sortent, comme un brocoli. En taillant progressivement, je peux récolter à partir des mêmes plants pendant deux mois. Mais il y a des incompétents qui vont là-dedans et qui arrachent tout ! »
Ne lui demandez donc pas quels sont ses lieux de cueillette, il ne les dévoilera pas. « Avant, je lettrais mon camion. Je ne le fais plus, parce que quand les gens le voyaient, ils se disaient : “Si Brouillard est là, c’est parce qu’il y a du stock !” » souligne-t-il en riant, un peu d’amertume dans la voix.
L’entrepreneur réclame de l’action. Il milite au sein de l’Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux afin d’obtenir plus d’encadrement et de surveillance. « Il faudrait imposer des permis de cueillette pour une liste de plantes vulnérables et de plantes vedettes, en commençant par les têtes de violon », plaide-t-il.
Dans ce contexte, François fait tout ce qui est en son pouvoir pour laisser un bel héritage : il continue à former des cueilleurs respectueux de l’environnement, il sensibilise le public et surtout, il cueille. « J’arrêterai quand je ne serai plus capable. Je compte cueillir encore à 80 ans. C’est très demandant physiquement, mais il n’y a pas beaucoup de jeunes qui sont capables de me suivre ! »
Après avoir offert cette visite guidée de son monde, François ira porter une cargaison de mûres et de chanterelles au Marché Jean-Talon. Puis, il repartira à la recherche de champignons, dans des endroits mystérieux dont il garde l’emplacement secret.
Photo de Daphné Caron
*Ce texte est paru dans le numéro Norcité du magazine Caribou.
La grande famille des Marchés publics de Montréal est forte des producteurs, des marchands et des artisans qui la composent. Depuis des années et des générations, ils se lèvent tôt, expérimentent, ratent parfois, recommencent tout le temps, veillent, récoltent et réussissent ! Jour après jour, ils se tiennent fièrement debout derrière leurs étals comme au bout d’une table où ils nous invitent à manger. Ils sont le cœur et l’âme d’un marché, l’essence de sa personnalité, la raison pour laquelle on a envie d’y retourner. La série Portrait de famille tient à rendre hommage et à raconter l’histoire de ces piliers de nos Marchés publics.
Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région.