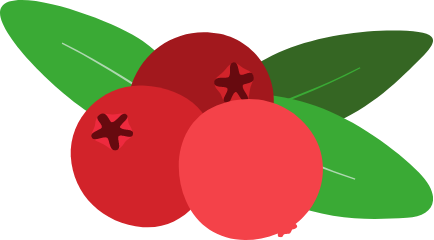C'est bon en salsifis

Poireau, oignon, échalote, ail, carotte, panais, patate en chapelet, crosne du Japon, bardane, céleri-rave, chervis, persil tubéreux, salsifis, scorsonère, topinambour, cerfeuil tubéreux, chou-navet, navet rose, navet noir, daïkon, rutabaga, rabiole, radis d’hiver, betterave rouge, betterave jaune, betterave chioga, chou-rave, céleri-rave, pomme de terre de toutes les sortes, patate douce, raifort, curcuma, gingembre…
Vous vous demandez sans doute pourquoi ce texte débute par une énumération. Et bien voilà. Ces légumes sont des racines. Des racines adaptées aux climats québécois. Des racines qui portent en elles une foule de nutriments essentiels. Des racines croquantes, tendres, sucrées, noisettées, amères, piquantes, savoureuses. Et des racines, surtout, qui se conservent l’hiver et qui pe mettent aux québécois·e·s de manger localement toute l’année, sans crainte de faire une écoeurantite de patates et de choux.
Cette diversité de légumes racines peut surprendre. Qui a déjà acheté du scorsonère ou des crosnes au supermarché ? Probablement personne. Mais les maraîchers et maraîchères québécois·e·s, animé·e·s par l’amour et par l’éthique environnementale que l’on attribue à la biodiversité potagère, sont de plus en plus nombreux et nombreuses à s’adonner à la culture de ces merveilleux aliments.
Si, à l’approche de la saison froide, vous avez la chance de tomber sur ne serait-ce que la moitié de ces variétés dans un marché, faites vite le plein. Avec un peu d’expérience et d’expérimentation, vous verrez que l’on peut très bien, grâce à ces racines colorées (ainsi qu’à leurs cousins les choux et leurs amies les courges), remplir son hiver de plats gastronomiques diversifiés et délicieux.
Carottes laquées au miel, papardelles de rutabaga, carpaccio de betterave, salade de topinambour cru, nigiri de chou-rave lactofermenté, curry de patate douce et curcuma, rémoulade de céleri-rave et cerfeuil, soupe de poireau gratinée, ravioles farcies au panais, gratin aux trois radis; les possibilités sont infinies.
Un truc de chef·fe? Pour un plat réussi, variez les textures et les saveurs. Du croquant et de l’onctueux; de l’amer, du sucré, du salé et de l’acide. Avec les racines, tout est possible, puisque la plupart d’entre elles se cuisinent autant cuites que crues (sauf peut-être la pomme de terre) et qu’elles adorent être déglacées au vin, laquées au sirop d’érable ou accompagnées d’une vinaigrette. Oui à un bouilli ou à une purée de temps en temps (c’est tellement réconfortant), mais ce que la racine veut vraiment, c’est être exploitée à son plein potentiel.
Et pour pouvoir jouir pleinement du bonheur apporté par les racines et les tubercules, il faut — en plus d’apprendre à les cuisiner — savoir les conserver. L’idéal, si on a cette chance, est de pouvoir les entreposer dans une chambre froide (entre 2 et 10°C), à l’abri de la lumière. Les carottes, les panais, les salsifis et les navets préfèrent qu’on les enterre dans des caisses remplies de sable sec. Si vous ne disposez que d’un réfrigérateur, l’idéal est de placer les légumes dans des sacs de plastique perforés.
Vous savez, on nous vante souvent les impacts positifs du locavorisme: environnement, économie, liens sociaux, conservation du patrimoine maraîcher… Mais au fond, la plus belle chose que cette autonomie alimentaire peut nous offrir, c’est le bonheur de savourer notre territoire et notre climat. Parce que oui, manger ce qui pousse chez nous, douze mois par année, c’est bon en salsifis.
Un texte d'Élizabeth Cardin, autrice de l'Érable et la perdrix et Le temps des récoltes, ainsi qu'ancienne restauratrice.