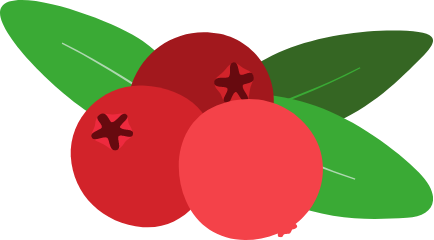Tisser les relations pour la souveraineté alimentaire

C’est un samedi après-midi au Marché Jean-Talon, et je suis à la recherche de tomates. Ce qui serait une tâche simple dans une épicerie devient ici un véritable défi car c’est la haute saison des récoltes. Les allées débordent de gens, de couleurs, de fruits et de légumes. Et les tomates ? Lesquelles choisir ? En grappe, ancestrales, cerises, raisins ? La diversité des variétés et des couleurs, tout comme les personnes qui les ont cultivés, m’inspire non seulement mille idées de recettes, mais me fait aussi réfléchir à ce qu’elle révèle de plus profond : une expression de la souveraineté alimentaire.
En 1996, à une époque de libéralisation commerciale rapide, la Via Campesina — un mouvement international de paysannes et paysans, de peuples autochtones et petits et moyens producteurs alimentaires — a commencé à parler de souveraineté alimentaire. Ce concept, peaufiné en 2007 au Mali, a été défini comme «le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l’aide de méthodes durables et respectueuses de l’environnement, ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles».
En tenant une tomate Brandywine dans mes mains, avec sa forme ondulée comme un fleuve et sa peau couleur de coucher de soleil après l’orage, je réfléchis à la manière dont la souveraineté alimentaire parle à des millions de personnes à travers le monde.
Ce terme rejoint l’idée que l’alimentation est fondamentalement une relation : avec le monde naturel, bien sûr, mais aussi entre nous.
Cet aspect relationnel est incarné dans la mission de Les Filles Fattoush, un traiteur et une entreprise sociale qui emploie des femmes syriennes, dont plusieurs sont arrivées à Montréal en tant que réfugiées. En plus de leur kiosque présent dans la zone resto, elles ont récemment ouvert un café au Marché Jean-Talon.
«Les Filles Fattoush, c’est bien plus que de la bonne nourriture : c’est aussi le partage humain», explique Cynthia Chackal, chargée de projets.
Le projet, lancé par Adelle Tarzibachi et Geneviève Comeau en 2017, visait à valoriser l’expertise culinaire de ces femmes syriennes. Avec les clients, Cynthia partage non seulement le secret d’un bon houmous («il faut ajouter des glaçons !»), mais aussi son héritage syrien. Cette relation se tisse aussi en cuisine, où chaque plat est préparé à la main, où recettes et récits circulent, et où les femmes retrouvent un sentiment d’appartenance.
«C’est fait avec amour, avec connexion, avec présence», dit-elle.
Pour Paul Toussaint, chef du restaurant 3 Pierres 1 Feu, également installé au Marché Jean-Talon, cette dimension relationnelle passe par les produits. Deux fois par jour, son équipe et lui parcourent les rangées pour s’approvisionner, comme si le marché entier était leur garde-manger.
«En Haïti, on vit pareil. On a la tradition d’aller au marché les matins», dit-il.
À son arrivée à Montréal, Paul a gardé cette habitude. Aujourd’hui, les légumes des kiosques comme Birri ou Le Roi du Maïs se retrouvent dans ses assiettes.
Dans une autre rangée du marché, l’équipe des Jardins d’Arlington vend jusqu’à 80 variétés de fruits et légumes pendant la saison, y compris différentes sortes de tomates. En opération depuis 2008, Claire Lanctôt, Nasser Boumenna, leur famille et leur équipe cultivent aujourd’hui 40 acres d’une manière biologique à Stanbridge Est.
« Nous avons à cœur les gens, ce qu'ils mangent, comment ils nourrissent leurs propres familles », confie Claire.
Une philosophie qui prend tout son sens quand on réalise l'ampleur du défi, car ils desservent 1500 à 2000 clients chaque semaine. L’importance de leur travail ne mesure pas seulement dans les ventes ou les kilos de légumes produits, mais aussi dans les liens humains, qui en retour donne un sens au travail ardu à la ferme. À leur étal, les producteurs et consommateurs redeviennent partenaires du projet de nourrir sainement nos communautés.
Dans un monde où les prix des aliments s’envolent, la souveraineté alimentaire peut sembler hors de portée. Mais en soutenant la production locale et écologique, nous montrons que l’alimentation n’est pas qu’une simple marchandise. Elle est aussi héritage, relations, et chemin vers un monde où ce que nous mangeons est bon pour nous, pour celles et ceux qui le produisent, pour l’environnement et pour nos âmes.
Rachel Cheng est une photographe, organisatrice communautaire et autrice basée à Montréal, où elle explore les liens entre alimentation, durabilité et justice sociale. Forte d’une expérience dans le milieu des OBNL, elle collabore sur des projets visant à bâtir un système alimentaire plus équitable et inclusif, tout en offrant des services de communication stratégique, de rédaction et de photographie publiés dans des médias tels que Condé Nast Traveller, Le Devoir ou La Presse.